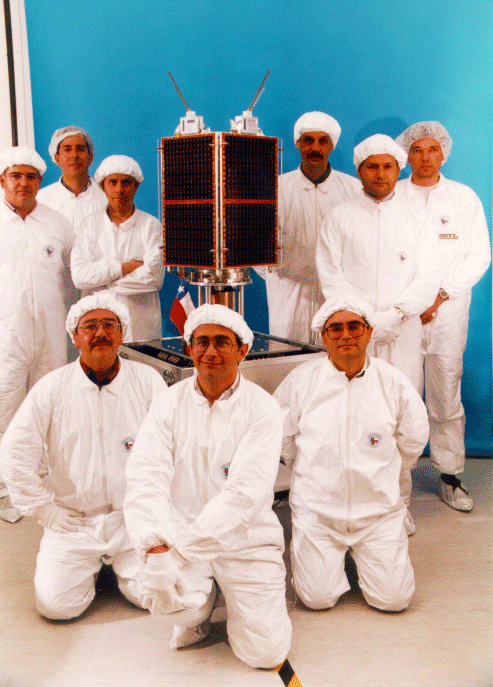
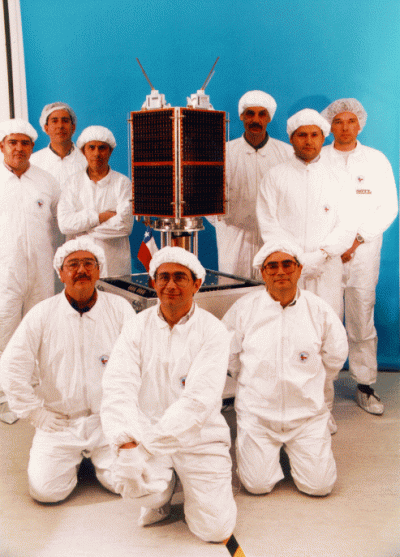
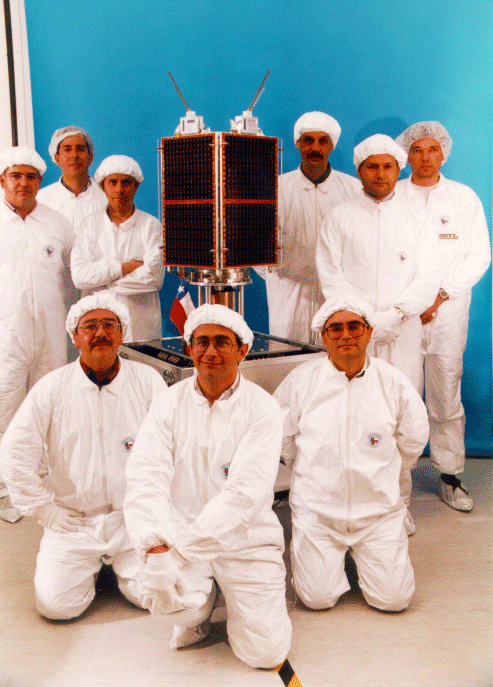
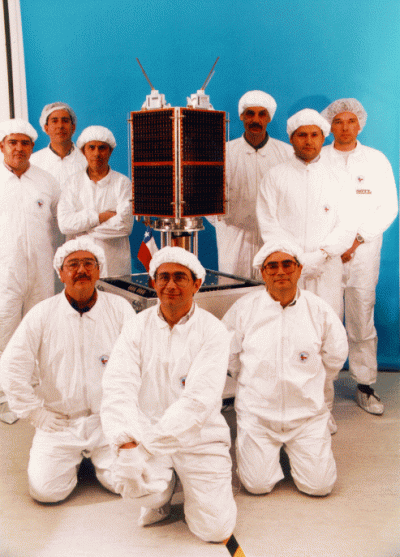
Le 31 août 1995, un lanceur ukrainien Tsyklon décollait avec notamment le satellite FASat-Alfa, qui devait faire du Chili un acteur du spatial.
Le Chili occupe depuis très longtemps une place singulière dans l’astronomie : grâce aux conditions météorologiques exceptionnelles dont il bénéficie dans le nord, il accueille en effet les plus grands observatoires nationaux et internationaux, dont ceux de l’ESO ou European Southern Observatory (La Silla, VLT, ELT) et de l’ALMA ou Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Etats-Unis, Canada, ESO, Japon).
Depuis plusieurs années, le pays cherche également à acquérir les technologies spatiales et à disposer de ses propres satellites.
Pendant la Guerre froide, à peine mise en place, la jeune NASA américaine propose à différents pays d’installer ses antennes de réception afin de suivre ses sondes spatiales. Le Chili est alors intéressé. En 1959, sa Faculté des sciences physiques et mathématiques (Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas / FCFM) répond favorablement à la proposition de la NASA. Cette dernière construit une première station de contrôle à Antofagasta (ville côtière dans le désert d’Atacama). Quelques années plus tard, un nouvel accord facilite l’installation d’une nouvelle station de suivi à Peldehue (40 km au nord de Santiago). Afin de renforcer la coopération, la FCFM créé une unité spécifique, le Centre d’études spatiales (Centro de Estudios Espaciales / CEE). Ainsi, des années 1960 aux années 2000/2010, le CEE participe au soutien et suivi de plus d’une centaine de vaisseaux spatiaux américains non habités et habités (Apollo, Apollo-Soyouz, navettes spatiales).
Le CEE forme les premiers spécialistes chiliens au traitement des informations reçues par les systèmes spatiaux, principalement les images des satellites de télédétection. Cela permet aux Chiliens d’acquérir des images des satellites américains Landsat afin de mieux gérer leur territoire, notamment au niveau des sols agricoles, de l’urbanisme, des littoraux, de la sécurité civile, etc. Un précieux apprentissage, comme s’en souvient Pedro Ramirez, alors jeune ingénieur civil électricien au CEE : « Grâce à des professionnels visionnaires, nous avons lancé dans les années 1970 un programme d'applications satellitaires pour la surveillance au sol et la recherche et le sauvetage d'avions accidentés. Ce programme a été pionnier non seulement au Chili, mais aussi en Amérique latine ».
Avec la fin de la Guerre froide, les investissements américains se tarissent. La FCFM poursuit et accroît son action dans la réception et la livraison de données techniques des satellites (télémétrie, télécommande, etc.). Elle apporte alors un soutien à d’autres nations (Japon, Chine, Allemagne, Suède) pour que celles-ci puissent avoir la possibilité de suivre leurs missions spatiales. « J'ai assisté, se souvient Pedro Ramirez, à plusieurs réunions au Japon et dans d'autres pays, et nos clients disaient toujours qu'ils pouvaient perdre des données de plusieurs stations, mais les données générées à Santiago arrivaient toujours à temps. Pour cela, poursuit-il, le centre [a rapidement disposé] de son propre financement grâce à davantage d'activités qu'auparavant. Cette initiative était révolutionnaire, car aucune organisation ne s'occupait de ce travail à l'époque. Une grande partie de notre expérience professionnelle consistait à fournir des services d'ingénierie aérospatiale à différents pays, une expérience sans précédent ».
De leur côté, les Forces Aériennes Chiliennes (FACh) s’intéressent depuis les années 1960 à la technologie des fusées. Des petites fusées-sondes sont même développées et expérimentées depuis Peldehue. Toutefois, faute de moyens financiers et de compétences technologiques suffisants, il est décidé d’abandonner l’idée de réaliser de puissantes fusées et de soutenir les initiatives concernant la surveillance spatiale.
A la fin des années 1980, au sein de l’Académie polytechnique aéronautique, une prise de conscience émerge quant au fait que la dimension spatiale aura immanquablement une place de premier plan lors du prochain millénaire. Dans ce nouveau contexte international, le commandant en chef des FACh, le général Ramón Vega, décide en 1993 la formation d'une équipe chargée d'étudier la possibilité de déployer un programme national de satellites. L’affaire reçoit l’aval du gouvernement mais, n’ayant pas encore la maîtrise des technologies spatiales, les responsables lancent un appel d’offre. Ce dernier est remporté par le groupe britannique Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL), dont le savoir-faire en matière de construction de satellites est reconnu. Le SSTL est en effet capable de livrer clé en main des microsatellites aux dimensions standardisées et de former des spécialistes (pour l’exploitation et la fabrication de satellites). Ainsi s’engage officiellement le 21 mars 1994 le programme FASast (Forces Aériennes Satellites).
SSTL construit FASat-Alfa et forme près d’une dizaine d’ingénieurs (pour le compte des FACh), afin d’acquérir des expertises technologiques et scientifiques. Pour recevoir les données des satellites, les FACh mettent en place à partir de l’été 1995 une station de contrôle et de suivi sur la base aérienne de Los Cerrillos (région métropolitaine). L’équipe chilienne est menée par le commandant Fernando Mujica Fernandez, chef de projet FASat-Alfa, dont la mission consiste à procéder à des expérimentations de télédétection et à effectuer des mesures de l’ozone. La question de l’ozone intéresse d’autant plus que le Chili est l’un des pays du monde les plus exposés aux rayons ultraviolets en raison de l’agrandissement du trou d’ozone et qui entraîne une explosion du taux de cancers de la peau.
FASat-Alfa doit alors être placé sur une orbite basse circulaire (autour de 650 km d’altitude) pour une durée de huit à dix ans. Ayant la forme d’un rectangle de 36 cm de côté pour une hauteur de 70 cm, le satellite a une masse totale de 50 kg. Outre des antennes de communication, il est également doté d’un bras de six mètres, muni à son extrémité d'une masse agissant comme un stabilisateur gravitationnel.
Le 31 août 1995, une fusée russo-ukrainienne Tsyklon-3 décolle depuis la base russe de Plessetsk emportant le satellite ukrainien Sich-1, auquel est attaché FASat-Alfa. Au moment du largage de Sich-1, le mécanisme de séparation (pinces, boulons explosifs) ne fonctionne pas… FASat-Alfa demeure alors attaché et ne peut fonctionner. C’est la déception tant pour les responsables chiliens que pour les médias. Les espoirs se portent alors sur le frère jumeau FASat-Bravo construit par SSTL grâce à une police d’assurance préalablement contractée.
[Suite publiée le 5 avril 2025 : https://air-cosmos.com/article/il-y-a-30-ans-le-chili-entrait-dans-l-aventure-spatiale-2-2-70432]
- Trois articles :
« Centro de Estudios Espaciales : el inicio », APABLAZA R. Marta, in Beauchef Magazine de l’Université du Chili, 27 mars 2018.
« FASat-Alfa, el primer satélite chileno : Descripción de la misión », MUJICA FERNANDEZ, Fernando, chef du projet FASat-Alfa, 27 février 2020
« A 25 años del lanzamiento del FASat-Alfa. Las esperanzas y frustraciones tras el primer satélite chileno », GARCIA Richard et BRAVO Juan Pablo, en ligne sur le site El Mercurio
- Un site dédié à FASat-Alfa.
Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence
Le 31 août 1995, un lanceur ukrainien Tsyklon décollait avec notamment le satellite FASat-Alfa, qui devait faire du Chili un acteur du spatial.
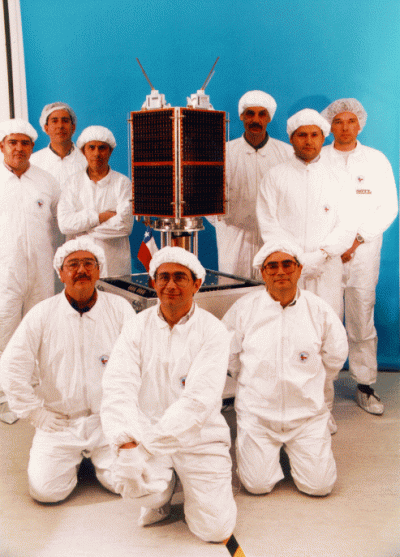
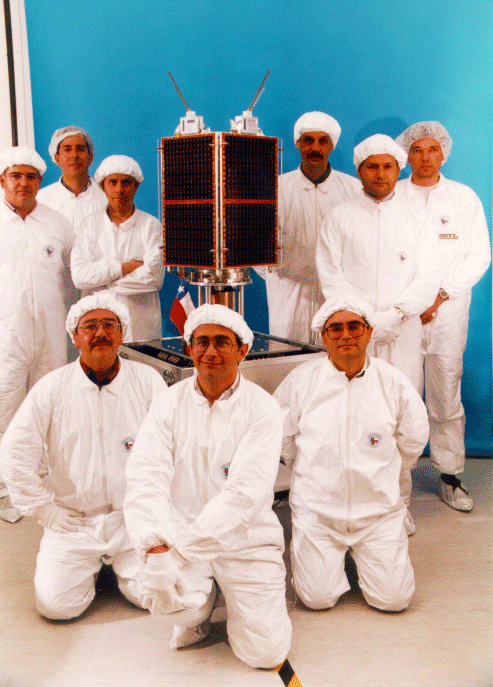
Le Chili occupe depuis très longtemps une place singulière dans l’astronomie : grâce aux conditions météorologiques exceptionnelles dont il bénéficie dans le nord, il accueille en effet les plus grands observatoires nationaux et internationaux, dont ceux de l’ESO ou European Southern Observatory (La Silla, VLT, ELT) et de l’ALMA ou Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Etats-Unis, Canada, ESO, Japon).
Depuis plusieurs années, le pays cherche également à acquérir les technologies spatiales et à disposer de ses propres satellites.
Pendant la Guerre froide, à peine mise en place, la jeune NASA américaine propose à différents pays d’installer ses antennes de réception afin de suivre ses sondes spatiales. Le Chili est alors intéressé. En 1959, sa Faculté des sciences physiques et mathématiques (Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas / FCFM) répond favorablement à la proposition de la NASA. Cette dernière construit une première station de contrôle à Antofagasta (ville côtière dans le désert d’Atacama). Quelques années plus tard, un nouvel accord facilite l’installation d’une nouvelle station de suivi à Peldehue (40 km au nord de Santiago). Afin de renforcer la coopération, la FCFM créé une unité spécifique, le Centre d’études spatiales (Centro de Estudios Espaciales / CEE). Ainsi, des années 1960 aux années 2000/2010, le CEE participe au soutien et suivi de plus d’une centaine de vaisseaux spatiaux américains non habités et habités (Apollo, Apollo-Soyouz, navettes spatiales).
Le CEE forme les premiers spécialistes chiliens au traitement des informations reçues par les systèmes spatiaux, principalement les images des satellites de télédétection. Cela permet aux Chiliens d’acquérir des images des satellites américains Landsat afin de mieux gérer leur territoire, notamment au niveau des sols agricoles, de l’urbanisme, des littoraux, de la sécurité civile, etc. Un précieux apprentissage, comme s’en souvient Pedro Ramirez, alors jeune ingénieur civil électricien au CEE : « Grâce à des professionnels visionnaires, nous avons lancé dans les années 1970 un programme d'applications satellitaires pour la surveillance au sol et la recherche et le sauvetage d'avions accidentés. Ce programme a été pionnier non seulement au Chili, mais aussi en Amérique latine ».
Avec la fin de la Guerre froide, les investissements américains se tarissent. La FCFM poursuit et accroît son action dans la réception et la livraison de données techniques des satellites (télémétrie, télécommande, etc.). Elle apporte alors un soutien à d’autres nations (Japon, Chine, Allemagne, Suède) pour que celles-ci puissent avoir la possibilité de suivre leurs missions spatiales. « J'ai assisté, se souvient Pedro Ramirez, à plusieurs réunions au Japon et dans d'autres pays, et nos clients disaient toujours qu'ils pouvaient perdre des données de plusieurs stations, mais les données générées à Santiago arrivaient toujours à temps. Pour cela, poursuit-il, le centre [a rapidement disposé] de son propre financement grâce à davantage d'activités qu'auparavant. Cette initiative était révolutionnaire, car aucune organisation ne s'occupait de ce travail à l'époque. Une grande partie de notre expérience professionnelle consistait à fournir des services d'ingénierie aérospatiale à différents pays, une expérience sans précédent ».
De leur côté, les Forces Aériennes Chiliennes (FACh) s’intéressent depuis les années 1960 à la technologie des fusées. Des petites fusées-sondes sont même développées et expérimentées depuis Peldehue. Toutefois, faute de moyens financiers et de compétences technologiques suffisants, il est décidé d’abandonner l’idée de réaliser de puissantes fusées et de soutenir les initiatives concernant la surveillance spatiale.
A la fin des années 1980, au sein de l’Académie polytechnique aéronautique, une prise de conscience émerge quant au fait que la dimension spatiale aura immanquablement une place de premier plan lors du prochain millénaire. Dans ce nouveau contexte international, le commandant en chef des FACh, le général Ramón Vega, décide en 1993 la formation d'une équipe chargée d'étudier la possibilité de déployer un programme national de satellites. L’affaire reçoit l’aval du gouvernement mais, n’ayant pas encore la maîtrise des technologies spatiales, les responsables lancent un appel d’offre. Ce dernier est remporté par le groupe britannique Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL), dont le savoir-faire en matière de construction de satellites est reconnu. Le SSTL est en effet capable de livrer clé en main des microsatellites aux dimensions standardisées et de former des spécialistes (pour l’exploitation et la fabrication de satellites). Ainsi s’engage officiellement le 21 mars 1994 le programme FASast (Forces Aériennes Satellites).
SSTL construit FASat-Alfa et forme près d’une dizaine d’ingénieurs (pour le compte des FACh), afin d’acquérir des expertises technologiques et scientifiques. Pour recevoir les données des satellites, les FACh mettent en place à partir de l’été 1995 une station de contrôle et de suivi sur la base aérienne de Los Cerrillos (région métropolitaine). L’équipe chilienne est menée par le commandant Fernando Mujica Fernandez, chef de projet FASat-Alfa, dont la mission consiste à procéder à des expérimentations de télédétection et à effectuer des mesures de l’ozone. La question de l’ozone intéresse d’autant plus que le Chili est l’un des pays du monde les plus exposés aux rayons ultraviolets en raison de l’agrandissement du trou d’ozone et qui entraîne une explosion du taux de cancers de la peau.
FASat-Alfa doit alors être placé sur une orbite basse circulaire (autour de 650 km d’altitude) pour une durée de huit à dix ans. Ayant la forme d’un rectangle de 36 cm de côté pour une hauteur de 70 cm, le satellite a une masse totale de 50 kg. Outre des antennes de communication, il est également doté d’un bras de six mètres, muni à son extrémité d'une masse agissant comme un stabilisateur gravitationnel.
Le 31 août 1995, une fusée russo-ukrainienne Tsyklon-3 décolle depuis la base russe de Plessetsk emportant le satellite ukrainien Sich-1, auquel est attaché FASat-Alfa. Au moment du largage de Sich-1, le mécanisme de séparation (pinces, boulons explosifs) ne fonctionne pas… FASat-Alfa demeure alors attaché et ne peut fonctionner. C’est la déception tant pour les responsables chiliens que pour les médias. Les espoirs se portent alors sur le frère jumeau FASat-Bravo construit par SSTL grâce à une police d’assurance préalablement contractée.
[Suite publiée le 5 avril 2025 : https://air-cosmos.com/article/il-y-a-30-ans-le-chili-entrait-dans-l-aventure-spatiale-2-2-70432]
- Trois articles :
« Centro de Estudios Espaciales : el inicio », APABLAZA R. Marta, in Beauchef Magazine de l’Université du Chili, 27 mars 2018.
« FASat-Alfa, el primer satélite chileno : Descripción de la misión », MUJICA FERNANDEZ, Fernando, chef du projet FASat-Alfa, 27 février 2020
« A 25 años del lanzamiento del FASat-Alfa. Las esperanzas y frustraciones tras el primer satélite chileno », GARCIA Richard et BRAVO Juan Pablo, en ligne sur le site El Mercurio
- Un site dédié à FASat-Alfa.
Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence
Commentaires